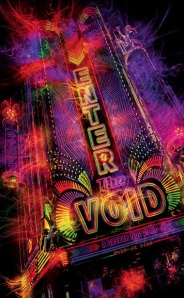Il existe des films qui appartiennent au registre purement psychopathe. Le silence des agneaux de Demme ou le Boucher de Chabrol, pour ne citer qu’eux. Le film de Uwe Boll, Rampage, est un objet brutal et agressif, à bien des égards aussi inattendu que stupéfiant.
La radicalité de l’histoire, son traitement et la violence de l’ensemble font que Rampage aurait pu être un épouvantable navet, le choix de faire un tel film était donc un risque assez grand. Bien au contraire, Rampage repousse les limites d’un genre assez délicat au cinéma: celui de l’ultra-violence.
L’histoire est simplissime, c’est celle de Bill Williamson, petit white trash teigneux, pur produit de la middle class WASP américaine, à tendance tanguyesque, puisqu’il semble se réjouir de rester chez ses parents, ce qui ne manque pas d’inquiéter ces derniers un peu plus chaque jour. Mais Bill n’est pas simplement une petite teigne, c’est un petit con violent et haineux, au final très nihiliste, sans que l’on donne, au final, une explication à l’origine de ses sentiments. Le personnage n’aurait été qu’un stéréotype de plus, si l’excellent Brendan Fletcher n’avait prêté ses traits à tel personnage. Belle performance qui lui fait composer un petit merdeux atavique, et pervers. Très bon choix de casting de la part de Uwe Boll, la crispation, la rancœur et l’intériorité bouillonnante trouvent ici un incarnat à la hauteur de leur intensité.
L’histoire, en suivant la destinée d’un seul personnage, est simple. Le traitement l’est tout autant: caméra épaule, montage cut, bien trop cut par moment, ce qui amoindrie la tension dramatique et le suivit narratif. Certains effets de montage relèvent effectivement davantage de la facilité stylistique ou rythmique, c’est dommage, mais après tout, ce n’est qu’un des rares défauts du film. Ce métrage est sauvage, la narration n’est qu’une véritable fuite en avant vers la mort et le carnage, rarement une tension aura connu un climax aussi efficace. Le montage est donc bien utilisé, sauf pour ces quelques scories visuelles que cet aspect du cinéma peut parfois amener dans les films de notre époque.
Le son, qui isole le spectateur dans le casque de Bill, nous coupant des réactions de ce qui l’entoure est une excellente idée de mixage, surtout lorsqu’il est couplé à des gros plans sur le visage du tueur. Le film ne semble pas avoir bénéficié d’un budget important, mais ses différentes composantes (image, montage, mixage etc.) sont bien exploitées… Rampage est un film plein d’idées de mise en scène.
Bill est un petit con qui gaspille sa vie, accessoirement celle des autres, mais Bill a un plan. Tuer tout le monde, « parce que des millions de gens naissent et consomment les réserves énergétiques de la planète »… L’idée est peut-être efficace pour lutter de façon drastique contre le surpeuplement, elle prend en tout cas ici la forme d’une tuerie sur vitaminée, pensée, logique et longuement préparée, qui fait passer les assassins de Columbine et de Virginia Tech pour des amibes hydrocéphales et autistes. Bill s’est patiemment construit une armure en Kevlar et accumulé un nombre important de matériel high-tech pour mener à bien sa « mission ». Le tout lui donne une allure étrange et hybride entre le GIGN du futur, et le monstre de série japonaise comme X-Or…
Le machiavélisme du plan de Bill surprend, et réside pour beaucoup dans la qualité du film. Bill détruit d’abord le commissariat, s’en prend ensuite aux forces de police restantes et les neutralise à coup d’uzi. Tendertown (quel nom ironique), petite bourgade américaine comme il en existe tant lui appartient. La moitié du film est un long carnage quasi continu, impitoyable et choquant. Aucune rédemption, aucune pitié ou presque, le film atteint l’intensité des plus grosses scènes de Peckinpah ou de Woo. C’est cette intensité et cette violence que la séquence du loto vient briser et prendre le reste du film à contre-pied, faire aussi comprendre au spectateur que le réalisateur de ce film n’est pas complètement dupe. Cette séquence est un des moments les plus hallucinants que le cinéma ait pu avoir à nous offrir, tant l’ambiance de ladite séquence est proprement surréaliste. Le film ménage également d’autres séquences aussi décalées ou surprenantes, son scénario n’est donc pas aussi simple qu’il n’y paraît.
On passe par divers stades émotionnels tout au long de ce film, on espère que l’instigateur du massacre se fera plomber bien vite, on espère que quelque chose arrêtera ce massacre mais non. Implacable jusqu’au bout, le plan de Bill fonctionne à merveille : il rentre tranquillement chez lui après avoir fait porter le chapeau à son unique ami, qu’il tue au passage, et après avoir dévalisé une banque. Tout est ingénieux dans son plan, précis, calculé. C’est cette froideur glaciale, accompagnée par le souffle de la violence sanglante des scènes d’actions, qui porte Rampage à un autre niveau que celui du film d’action.
La mort et la violence sont emprunts d’un tel naturel dans ce film que cela rend sa tonalité globale aussi marquante et provocante que glaçante. Le mal n’a jamais eu autant de facilité pour fasciner les gens que lorsqu’il est pur et intact…
Bill rentre tranquillement chez lui le soir, retrouver ses parents quelques peu inquiets par les événements, mais contents que leur fils soit sain et sauf et ait enfin des projets d’étude. Après ces quelques considérations familiales, ils se servent un double scotch… La thématique de Donnie Darko est déclinée ici en version Soldier of fortune, telle est la composition de Rampage. Le pari était risqué, les deux films ont quelques ressemblances, mais chacun porte sa propre inspiration. On peut ici parler du courant plutôt que d’influences: Donnie Darko et Rampage sont des films sur le mal-être et les non-dits qui règnent parfois au sein des familles et de la société américaine, ainsi que sur les quelques conséquences que cela peut avoir. Mais chacun avec son approche et son traitement, le rêve/cauchemar et la psychiatrie pour Donnie Darko, l’isolement et la haine pour Rampage. Mais là où Donnie Darko préfère le rêve et l’allégorie, Rampage montre les limites d’un système et la mort qu’il peut semer, lorsque l’un de ses éléments s’est fixé comme but de le voir bruler…
Film direct, simple mais incisif, pervers, violent et implacable. Rampage est un monument de nihilisme, qui dit bien plus de choses qu’il n’y parait au premier abord… Le film de Uwe Boll est une réussite tout à fait surprenante et inattendue.
A.C